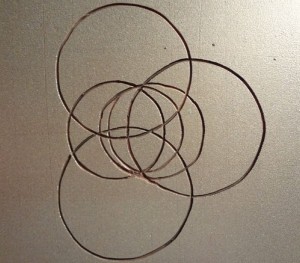La musique de jeux vidéo commence enfin à gagner ses lettres de noblesse avec le regain d’intérêt ces dernières années pour les années 80/90. Le tout jeune Data Discs s’inscrit dans cette dynamique et réalise un travail absolument merveilleux en proposant des vinyles de bandes originales dans des éditions de haute qualité. Bien que cet entretien n’évoque pas en détail le business model particulièrement efficace du label, il permet de mieux comprendre l’état d’esprit de son fondateur, Jamie Crook.
Merci de respecter mon travail et de ne pas vous approprier mes traductions. C’est par pure volonté d’échange que je mets ces écrits à votre disposition. Contactez-moi pour tout autre renseignement.

Auteur original : Nick Spacek
Source : Starburst
Support : Magazine en ligne (22 novembre 2015)
Data Discs n’existe que depuis quelques mois mais a déjà réussi le pari de sortir trois disques en très peu de temps. Leurs rééditions en vinyle de musique des jeux vidéo Streets of Rage, Shenmue et Shinobi III ont été largement saluées par tous ceux qui les ont écoutées. Si l’on ajoute à ça les prochaines éditions d’Outrun et de Streets of Rage 2, on peut d’ores et déjà dire que Data Discs est le label incontournable des bandes originales vidéoludiques. Nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques questions au fondateur du label, Jamie Crook.
Dans quelle mesure avez-vous travaillé avec les compositeurs ?
Ça dépend. Quand on développe des produits sous licence comme les nôtres, c’est un peu utopique de croire qu’on travaillera toujours directement avec les compositeurs. Parfois, quel que soit notre enthousiasme et notre désir de les impliquer davantage, c’est tout simplement impossible. La distribution de produits licenciés avec de grandes entreprises ne fonctionne pas comme ça. Nous avons collaboré étroitement avec Yuzo Koshiro pour Streets of Rage et nous continuerons de le faire pour le reste de la trilogie. C’était un plaisir de travailler ensemble. C’est lui qui nous a fourni les fichiers NEC PC-88 de Streets of Rage (Bare Knuckle au Japon), ce qui nous a permis d’explorer de nombreuses choses lors du processus de masterisation. Au final, après avoir demandé conseil au compositeur, nous avons opté pour un mélange des pistes PC-88 et de captures directes d’une Mega Drive modifiée, afin d’obtenir les masters les plus convaincants selon les spécificités de chaque morceau. Evidemment, il avait son mot à dire sur la version définitive.
Quelles ont été les réactions de vos collaborateurs à la sortie des vinyles ?
Pour nous, c’est très important de satisfaire à la fois les compositeurs et les ayant-droits avec nos produits. Je crois que jusqu’ici, c’est réussi.
La musique de jeux vidéo fait l’objet de nombreuses réinterprétations, à travers les variations progressives de Minibosses ou de Powerglove, ou les versions orchestrales de ‘Video Games Live’. D’après vous, que peut offrir de particulier la musique originale ?
Les gens n’ont cessé de revisiter et d’adapter la musique de jeux vidéo depuis son apparition, même chez les éditeurs (par exemple, SEGA et TAITO avaient leurs propres groupes en interne, respectivement le S.S.T. Band et Zuntata). Depuis plus de trente ans, les jeux vidéo ont une influence énorme sur la culture populaire ; mais il semblerait en effet que récemment, ils soient devenus à la mode. C’est le résultat de facteurs confluents, pas simplement de la nostalgie. Les enfants des années 80 sont maintenant des adultes qui commencent à réaliser l’impact, conscient ou non, que les jeux de leur enfance ont eu sur leur identité. En ce sens, c’est le moment idéal pour développer des projets comme le nôtre. Il y a quelque chose de très gratifiant à redécouvrir la musique originale, hors de son contexte vidéoludique, et à la considérer comme création artistique à part entière. C’est aussi très réconfortant, bizarrement.
Sur le podcast Damn Fine, le compositeur Disasterpeace a soulevé un point intéressant, la contradiction de proposer de la musique électronique sur un format analogique. Quel est votre avis sur la question ?
Une large majorité de la musique actuelle est enregistrée selon des processus numériques. Pour commencer, un enregistrement purement analogique doit être issu d’une cassette, ce qui devient de plus en plus rare (pour le meilleur et pour le pire). Opposer de façon binaire l’analogique du numérique est trop simpliste ; ce sont juste différents outils que les artistes et les ingénieurs peuvent exploiter à leur guise. Souvent, la musique la plus intéressante se base sur leur interaction, qu’elle soit récente ou non.
Quels ont été les retours sur les trois vinyles parus à ce jour ?
Je suis très heureux de dire qu’ils ont été extrêmement positifs.
Croyez-vous que le fait d’attendre que les disques soient en cours de pressage permette d’éviter des problèmes rencontrés par d’autres labels ? Certains d’entre eux proposent des précommandes avant cette étape, générant de longs mois d’attente, tandis que vos disques sont livrés à temps…
La précommande est un sujet épineux sur lequel les labels indépendants tentent toujours de trouver le bon équilibre. Avant d’y penser, nous nous assurons d’abord que nos disques soient en usine, ce qui revient à estimer le niveau de la demande pour décider de la quantité à presser. C’était compliqué pour nos deux premières références, Streets of Rage et Shenmue, puisque nous avions alors peu de connaissances vis-à-vis du potentiel de nos sorties. Jusque-là, personne d’autre n’avait édité en vinyle des musiques originales de jeux vidéo, c’était un saut dans l’inconnu ; mais sans inquiétude outre-mesure, puisque le label pouvait compter sur deux titres très solides, dans des styles absolument différents mais tout à fait géniaux. Pour en revenir aux précommandes, elles sont presque essentielles de nos jours, étant donné l’état actuel du marché du vinyle – même si nous sommes fiers d’avoir proposé notre troisième titre, Shinobi III, sans aucune période de précommande. Cela dit, des labels ont fréquemment recours à cet outil pour financer leurs sorties, ce qui est assez injuste ; c’est prendre le consommateur pour une facilité de crédit, alors que la précommande ne devrait que permettre aux gens de réserver des exemplaires à l’avance.
Les bandeaux promotionnels (OBI) permettent d’uniformiser toutes vos sorties, mais était-ce le but recherché ou juste un clin d’œil aux racines japonaises des musiques ? Même chose pour l’esthétique des pochettes faisant référence au packaging des jeux vidéo ? Je pense notamment aux premiers jeux CD sortis sur Playstation, par exemple.
Notre catalogue fonctionne comme une collection, certains éléments de design doivent donc permettre de reconnaître le « style de la maison » (notamment l’obi, la tranche et le label). Ces choix ont été largement plus inspirés par les disques d’ambient japonais que les emballages de jeux vidéo.
Est-ce un choix de ne pas avoir inclus de livret ?
Pas vraiment, mais je ne pense pas que ce soit important. En général, nous évitons de charger nos sorties avec des objets superflus pour laisser la part belle au son dans un écrin élégant et distinctif. Trop de promotion et de marketing peuvent rapidement nuire à une sortie.
En quoi consiste exactement le processus de masterisation de musique purement numérique pour un format analogique ? Des données sont-elles perdues en cours de route ?
Nos sources audio (consoles, systèmes d’arcade, etc.) sont réalisées à partir d’échantillonnages haute résolution capturant un large spectre de bits. Elles sont ensuite envoyées à notre ingénieur son (le plus souvent, mon frère) qui prépare les enregistrements pour le format vinyle, ce qui implique la prise en charge des timings et des dynamiques, des incompatibilités et autres problèmes potentiels relatifs aux fréquences. Et puis, des choix créatifs sont faits pour exploiter à fond la matière brute. Nos disques sont destinés aux platines, ils doivent générer une expérience d’écoute agréable, comme de vrais albums musicaux. Pour en tirer le meilleur parti, il faut parfois réduire les sons grinçants qu’on n’entendrait pas sur un téléviseur, mais qui prendraient une dimension trop manifeste sur un équipement hi-fi, et reconstituer un ensemble homogène.
Je ne dirais pas qu’on perd quelque chose en route ; après tout, nous capturons la matière audio à une résolution bien plus haute que la source originale. Notre principal objectif, c’est de faire profiter des caractéristiques sonores et esthétiques du vinyle à la musique. Si nos disques ressemblaient en tous points aux sons originaux – dont la plupart sont déjà disponibles ailleurs – alors notre entreprise n’aurait aucun sens. Personnellement, j’adore ce mariage inhabituel entre deux formats très différents et les nouvelles possibilités sonores qu’il permet. Il ne s’agit pas seulement de produire les éditions les plus « authentiques » ou « définitives » de ces bandes originales, mais de les faire revivre de manière originale. Et puis, nous espérons que ces disques seront une passerelle par laquelle les gens s’intéresseront davantage au vinyle et aux incroyables labels qui travaillent sur ce format de nos jours.. □ B.M.
Plus d’informations sur les sorties du label Data Discs sont disponibles sur data-discs.com.